|
Paulette
Morel-Terrien
Le
Masgoulet
Ce
texte de témoignage figure dans l’ouvrage coordonné par Jeannette
Dussartre-Chartreux,
Les Ponticauds : ce fut leur histoire, Association Les Amis de
Lucienne Lasserre, Limoges, 1991, p. 24-25.
Nous remercions vivement Jean-Loup
Terrien et Jeannette Chartreux de nous en avoir autorisé la
publication.
Issue
d’une famille de la bourgeoisie de Limoges, de tradition chrétienne
au sens vrai du terme, et profondément républicaine (mon père s’est
battu contre le Colonel de la Roque et ses croix de Feu en 34 et par la
suite contre le PSF et mes parents ont fait une guerre " exemplaire
" cachant les Juifs et les Américains, organisant (en commençant
par leur propre demeure) l’exode des réfugiés alsaciens, puis des réfugiés
belges. Consul de Belgique, le travail de mon père en temps de paix
consistait pour l’essentiel, à mettre dix tampons par an sur un
passeport ! Pendant la guerre, il participa à l’accueil des réfugiés
parisiens et parallèlement, au parrainage et à l’envoi de colis aux
gars du STO. La guerre terminée, il eut en charge le rapatriement des
prisonniers de retour des camps, tout en défendant comme il le pouvait
tous les habitants de l’immeuble contre les Allemands, qui en
occupaient le premier et le deuxième étages, dirigeant avec le
directeur de l’EDF le secours américain, etc. J’ai partagé toutes
ses tâches avec eux et appris le sens du mot solidarité.
Ayant
quitté mon milieu d’origine par vocation évangélique et choisi de
partager le sort de la classe ouvrière et celui, en son sein, des plus
pauvres, je me suis tout de suite orientée vers « les Ponts ».
J’ai trouvé, grâce à Henri Chartreux, prêtre-ouvrier qui habitait
lui-même le quartier au rez-de-chaussée du n° 8 de la rue du
Masgoulet, une mansarde avec une lucarne au troisième étage du n° 17
de la même rue et obtenu du travail à l’usine de porcelaine GDA -
Faubourg des Casseaux.
J’y ai travaillé 12 ans comme
« garnisseuse de fabrication »,
« colleuse de queue » comme on disait dans notre jargon
d’ouvriers porcelainiers. Dans les deux usines de porcelaine du
faubourg des Casseaux, à l’usine Legrand (qui n’avait pas la taille
qu’elle a actuellement) et à l’usine de chaussure Heyraud en ville,
travaillaient un grand nombre de Ponticauds ; ceux des deux « rives »,
Enfants de la Vienne ou Marins du Clos !
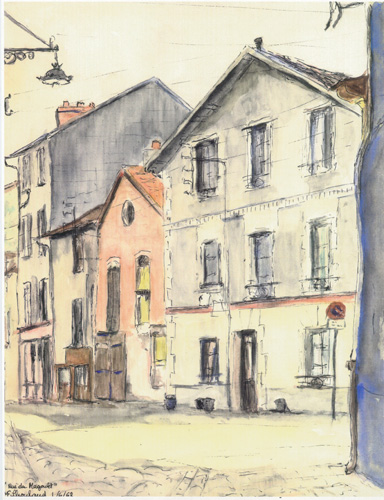
Michel
Filhoulaud, vue de la rue du Masgoulet, 01/06/1968
A
côté de ma maison (qui abritait dans ses six pièces, trois familles
avec leurs enfants et deux célibataires, dont moi), une autre, plus
petite, servait de logement à une famille avec ses enfants et quatre célibataires,
le tout dans six pièces également, le rez-de-chaussée servant
d’entrepôt.
Il
y avait derrière chacune de ces
masures une courette et
au fond, les W.C,communs à tous les locataires. On allait
chercher l’eau (et faire sa lessive) avec des seaux à la fontaine
unique, au bout de la rue côté faubourg des Casseaux. Et puis un jour,
en 1950 (c’était en hiver à la fin de l’année), rentrant à
minuit d’une réunion, en arrivant devant chez moi j’ai trouvé des
étais s’élevant jusqu’au deuxième étage posés sur les deux
maisons et des barrières de sécurité alignées jusqu’au milieu de
la rue - et, en faction devant l’ensemble, un agent de police.
J’ai
demandé à celui-ci ce qui se passait. Il m’a répondu qu’un des
habitants de la maison mitoyenne ayant entendu chez lui des sombres
craquements, avait alerté la mairie, qui en avait référé aux
services de sécurité de la ville. Le maire avait aussitôt dépêché
quelqu’un sur place pour se rendre compte de l’état des deux
immeubles dont les toitures et les murs étaient imbriqués les uns dans
les autres. Léon Betoulle avait déjà eu sur les bras une affaire
difficile, place des Bancs : une maison menaçant ruine s’était écroulée
sur une partie de ses habitants. Ces derniers avaient heureusement pu être
dégagés sains et saufs, ou sans blessure grave, à l’exception hélas
d’une personne âgée qui avait été écrasée sous les gravats. Ces
maisons n’avaient pas été évacuées à temps, alors qu’elles
donnaient des signes de faiblesse alarmants. C’est pourquoi, ne
souhaitant pas voir se renouveler pareil drame, il avait ordonné l’évacuation
sur le champ des familles qui occupaient les numéros 15 et 17, avec
l’aide des pompiers, de la police et des agents municipaux. J’ai
demandé à l’agent de police à quel endroit les habitants avaient été
relogés. Il m’a
répondu : « certains
chez des
voisins, des
amis, ou
de la
famille ». A
ma question : « et les autres?" (les autres c’était
ceux dont personne n’avait voulu !), avec un peu de gêne il m’a
informé : « à l’hôpital dans un pavillon désaffecté ! »
Il s’agissait en
fait du pavillon des « contagieux »,
laissé libre en permanence pour faire face à une épidémie),
puis il ajouta : « si vous ne savez pas où aller, je vais vous
faire un bon pour le gardien de l’entrée qui vous indiquera le lieu
exact, mais il faut être parti
à 7
heures du
matin et
rentré le
soir à
21 h ». Où
aller ? Je
le savais. J’avais
cinquante portes qui s’ouvriraient si je frappais, mais j’avais déjà
fait mon choix : « Si on a mis là-bas tous ceux dont personne ne
veut, ils ne sont pas prêts d’en sortir et d’être relogés – et
les autres pas davantage ». Ma place était avec eux, pour que
tous ensemble nous nous battions pour obtenir une nouvelle habitation.
J’ai
demandé si je pouvais récupérer quelques affaires. Il me fallait, au
moins, ma deuxième blouse de travail, des habits de rechange et divers
objets usuels. L’agent m’a dit : « D’accord, je monte avec
vous. Mais pour vos meubles, c’est impossible, les camions de la
mairie sont partis ». J’ai donc laissé sur place mon maigre
bien, ne sachant pas si je pourrais le récupérer un jour ou l’autre,
avant la démolition. Oh, il me fallait si peu de choses pour vivre.
Quelques copains solidaires me fourniraient bien l’indispensable !
Le mobilier des autres avait été entreposé dans un hangar transformé
en « garde-meubles » mis à disposition par la mairie.
Après
avoir remercié l’agent de police, j’ai chargé mon balluchon sur
les bras et pris le chemin de l’hôpital. On nous avait mis dans une
salle commune, les femmes et les hommes ensemble. A 4 heures du matin,
le grand Joseph qui avait emporté sa lampe à alcool et une casserole
faisait la « chicorée » pour toute la smala. Il
embauchait à
cette heure-là.
Nous perdions ainsi
deux heures
de sommeil,
mais au moins nous
avions quelque chose de chaud dans le ventre, même s’il fallait subir
la vexation du portier qui matin et soir fouillait nos sacs. Je crois
bien que c’est le seul hiver où depuis longtemps nous ne nous sommes
pas gelés, l’administration de l’hôpital ayant poussé la générosité
jusqu’à laisser les radiateurs ouverts.
Nous
sommes restés là un ou deux mois je crois. Mais il a fallu se battre
pieds et poings liés pour obtenir un relogement pour les familles et
les célibataires. La
mairie a donné l’adjudication à une entreprise de la ville pour la
transformation de l’ancien centre d’apprentissage situé à la place
actuelle du parc des sports, où nous avons vécu dans des conditions
indignes (les cloisons étaient faites de planches non jointées, et on
pouvait se passer le journal ou une cuillère à travers la cloison
d’un appartement à l’autre... et chacun pouvait voir son voisin
faire ses besoins sur un seau, que nous allions vider dans l’herbe,
dehors, un peu plus loin, car il n’y avait pas de W.C. Trois ans après
nous avons été relogés dans d’autres baraquements situés sur le
flanc droit du stade. C’était légèrement mieux malgré une toiture
en tôle et des cloisons de trois centimètres. Il y avait cinq W.C.
pour 90 familles et un robinet par baraquement. Mariés en 1959, nous y
sommes restés avec Claude jusqu’en juillet 60, où en raison de la
grave maladie de notre fils, et ne trouvant rien de potable, nous avons
pris un logement en accession à la propriété dans un immeuble
Baticoop dont l’attribution était soumise à un plafond de ressources
familiales, y compris les A.F.
Les
numéros 15 et 17 de la rue du Masgoulet ont été démolis peu de temps
après, par sécurité. On en voit l’emplacement sur la photo
ci-contre communiquée par les Archives Municipales. [voir
cette photo, avec d'autres, sur le site des Enfants de la Vienne]
1
Emplacement du four à porcelaine, préservé de la destruction et
intégré dans le patrimoine historique du Limousin grâce à
l’action persévérante de l’association Renaissance du Vieux
Limoges et de son président Jean Levet. Note J. Chartreux.
|
Accueil
Présentation
Témoins
Textes et documents
Images
bibliographie
|