|
Shimazaki
Tozon :
les
bords de Vienne et ses gens vus
par
un écrivain japonais (1914)
En 1914 un écrivain japonais de premier
ordre, Shimazaki Tozon (1872-1943), que l'on considère comme l'un des
représentants majeurs du courant "naturaliste"
(Shizenshûgi) (1), séjourna quelques mois
à Limoges. Il résidait à Paris quand la guerre éclata et, devant
l'avancée des troupes allemandes, sa logeuse, Marie Simonet, lui conseilla de se
réfugier à Limoges où elle avait de la famille. Il s'y rendit en
compagnie d'autres pensionnaires dont son compatriote, le peintre Masamuné
Tokasuburô. La petite maison où il habita existe encore, tout
au bout de la rue de Babylone. Jean-Pierre Levet, enseignant à
l'université de Limoges, a eu la gentillesse de nous communiquer des
passages de son oeuvre (Lettres de France et L'étranger),
où l'écrivain évoque les quartiers des bords de Vienne, et surtout
ses habitants. On notera en particulier sa très grande attention pour les
enfants, avec lesquels ce jeune homme d'une quarantaine d'années se
plaît à jouer et à bavarder. Ainsi se dit-il ému aux larmes en
entendant des petites filles chanter en limousin pour le remercier du don
d'un paquet de gâteau.
On
trouvera une notice sur Shimazaki et la version japonaise d'une partie
des textes que nous présentons ici sur le site de l'association Renaissance
du Vieux Limoges.

« Le
Pont-Neuf est un grand pont en pierre qui se dresse entre mon quartier
et le centre de la ville. Sous ce pont coule la Vienne... » (Les
Lettres de France, 11 novembre 1914).
***
« Près
du Pont-Neuf, il y avait un petit café sans prétention, à
l’enseigne du Comptoir.. Chaque fois que mes pas me conduisaient en
cet endroit, le fils des patrons courait vers moi pour me serrer la
main. Même lorsque cet enfant jouait en compagnie de petits camarades
au pied des arbres, il ne manquait pas de venir à la hâte me saluer.
Il s’était donc bien habitué au voyageur étranger que j’étais... »
(Lettres de France, 11 novembre 1914)
***
« A
ces petites filles, j’ai donné un paquet de gâteaux et nous sommes
devenus de si bons amis qu’elles m’ont chanté des chansons. En
entendant ce chant en langue limousine qui sortait de la bouche
d’innocentes fillettes, j’ai versé des larmes... » (ibidem).
***
« En
me rendant du chemin de Babylone à la Vienne, j’ai rencontré trois
ou quatre fillettes que je connaissais. Nous étions bons amis depuis le
jour où j’avais sauté à la corde avec elles. Toutes les fois
qu’elles me voyaient, elles me disaient : « Monsieur le
Japonais, venez donc jouer avec nous » (L’Étranger, 1914).
***
« J’ai
aperçu, sur le seuil d’une porte, un enfant qui tenait un morceau de
pain et du fromage dans la main. Il n’y a aucune différence entre un
enfant français dévorant du pain avec plaisir et un petit garçon
japonais mordant avidement dans une boule de riz... » (L’Étranger)...
***
« Un
garçon s’est approché de moi et m’a demandé de lui parler du
Japon. « Quel est le plus beau pays », m’a-t-il demandé,
« la France ou le Japon ? » Sa question m’a embarrassé :
« Hum... toute comparaison est impossible. Dans ton pays, on
trouve du beau et du moins beau, n’est-ce pas ? Eh bien, au
Japon, c’est la même chose » « De quelle couleur est la
mer au Japon ? Est-elle jaune ? » « Pourquoi donc
serait-elle jaune ? Elles est bleue, bien sûr, d’un bleu très
clair, elle est splendide ». « Ah ? D’un bleu très
clair », a-t-il répété. Il semblait rêver à cet Orient
inconnu. Frappé par sa vivacité d’esprit, qui l’avait poussé à
poser une question sur la couleur de la mer pour s’informer sur un
pays étranger, je fixais un instant ses yeux innocents » (L’Étranger).
***
« Je
suis descendu sous le pont. Là, on entendait d’habitude le bruit du
linge que l’on battait, mais, ce jour-là, les lavandières n’étaient
pas nombreuses. Sur la rive, entre les platanes aux feuilles jaunies et
l’endroit où l’on faisait sécher le linge, je contemplais les
enfants du quartier qui jouaient. L’envie me prit de faire des
ricochets devant un enfant. La pierre plate et bien lisse que j’avais
ramassée et lancée a rebondi jusqu’au milieu de la rivière. En
l’apercevant, les enfants se sont approchés de moi et m’ont demandé
de leur apprendre à faire de tels ricochets. Parmi eux, certains
apportaient des pierres rondes ramassées sur la rive ; d’autres
essayaient de lancer des cailloux. Tout le monde s’amusait. Je me suis
demandé si ce jeu qui se pratique au bord de l’eau n’était connu
qu’au Japon et si ces petits Français n’y avaient jamais joué »
(L’Étranger).
***
« Sur
la colline, j’ai dressé l’oreille et, alors, j’ai entendu le
bruit sourd de la Vienne qui coulait dans la vallée » (L’Étranger).
***
« Certains
jours, le murmure de la Vienne parvenait jusqu’à la prairie située
du côte gauche du chemin de Babylone. C’est de ce lieu-là, et plus
précisément de la petite colline qui s’élève en cet endroit,
qu’un jour nous avons aperçu des montagnes dans le lointain. De là,
on voyait trois églises anciennes. La plus proche, à notre droite, sur
l’autre rive de la Vienne, était la cathédrale Saint-Étienne ;
au centre, plus loin, il y avait l’église Saint-Pierre, et, sur la
gauche, l’église Saint-Michel » (L’Étranger)
***

la
maison où séjourna Shimazaki Tozon, rue de Babylone
« Sur
la rive opposée, sur le terrain en pente, on entrevoyait des maisons
rustiques alignées, ainsi que des jardins cultivés... » (L’Étranger)
***
« A
deux pas de notre logement, des vaches paissaient ; des fermières
chaussées de sabots suivaient une charrette que tiraient des bœufs ;
la rosée matinale humectait les feuilles de la vigne et des gens âgés
labouraient péniblement, en pensant sans doute à leurs fils au front »
(L’Etranger).
***
« La
Vienne avait pris son aspect automnal » (L’Étranger).
***
« L’église
Saint-Étienne est une immense cathédrale en pierre. La chapelle, qui
se trouve au détour de la rue en pente conduisant à la cathédrale,
m’a rappelé que nous étions dans un pays catholique. A côté de
cette chapelle, une vieille femme ridée, le dos voûté, vendait de
grands cierges. Au pied de la statue de Marie, on avait déposé des
cierges et des fleurs. De façon très surprenante, il s’agissait de
lotus artificiels, dont les feuilles et les pétales de couleur or et
argent ont suscité en moi l’impression que j’étais dans un temple
bouddhique. Sous la lueur vacillante des cierges placés sur l’autel,
nous avons vu une jeune fille, vêtue d’une robe noire, qui priait,
agenouillée, sur une marche en pierre. Peut-être priait-elle pour le
retour de son fiancé parti pour le front » (L’Étranger).
***
« Je
vais dire adieu à la prairie où je me suis si souvent assis, aux toits
rouges et aux immeubles serrés de l’autre rive, ainsi qu’à la tour
élevée de la cathédrale Saint-Étienne, qui semble dominer la ville
de Limoges dans son ensemble. Je n’aurai plus jamais le bonheur de les
revoir » (Les Lettres de France).
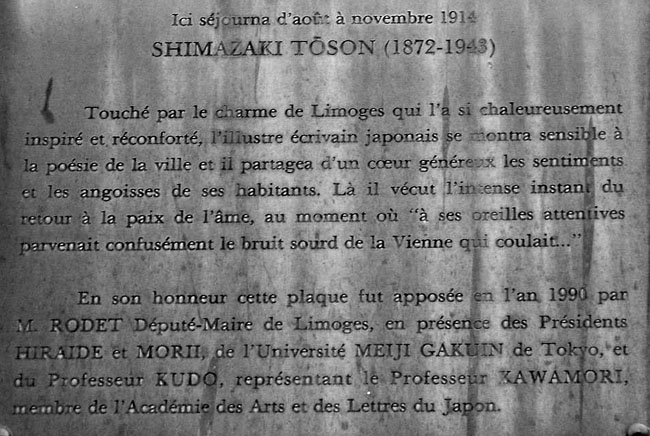
plaque commémorative apposée sur
la maison où Simazaki séjourna, rue de Babylone
(1)
Deux de ses romans sont traduits en français : Hakaï
(1906) : La transgression, trad. du japonais par Suzanne Rosset, Paris,
You-Feng, 1999 et Ié : Une
famille ; trad. du japonais par Suzanne Rosset, Paris,
POF, 1984. On peut lire la bonne notice qui lui est consacré dans le Dictionnaire
des littératures françaises et étrangères, sous la direction de
Jacques Demougin, Larousse, 1985. Voir également les pages web : http://www.shunkin.net/Auteurs/?book=532
(sur Hakai) http://www.meijigakuin.ac.jp/~french/professeurs/doc/kudo25.pdf.
(sur le séjour à Limoges)
|
Accueil
Présentation
Témoins
Textes et documents
Images
bibliographie
|