|
Anecdotes
de la légende ponticaude
Nous
publions deux articles signés André Dexet (alias Panazô), parus dans l’Écho
du centre, les 20 et 21 février 1951. Ils sont riches
d’information sur la langue et la vie quotidienne. L’auteur a
notamment pu parler, encore à cette date, avec un vieil ami qui avait
connu le flottage. Il y rappelle aussi, entre autres choses, que le
Limousin était au début du siècle la langue parlé par tous les
habitants du quartier, et que les parents l’enseignait encore sans
vergogne à leurs enfants, situation inconnue de nos informateurs
aujourd’hui, même les plus âgés.
Nous
pouvons surtout constater qu’il y a plus de 55 ans déjà on considérait
les ponticauds « authentiques » comme appartenant au passé.
Autrement dit, la légende était née…
Les
illustrations on été ajoutées par nos soins
20
février 1951
Avec les derniers et authentiques
« Ponticauds »
Il s’en est succédé, des générations de Ponticauds depuis
« Lemovice » !…
Et
sous le pont Saint-Etienne, en a-t-il coulé de l’eau de la Vienne !
Mais
les Ponticauds sont encore là… Le pont aussi d’ailleurs. Il n’en
reste plus beaucoup d’authentiques et, il faut bien le dire, Limoges
sans ses Ponticauds ne sera plus Limoges ! Leurs traditions sont
tenaces, solides, éternelles comme le pont lui-même.
Je
vais essayer de vous décrire ce qu’il en reste ou ce qu’il en
restait il y a 50 ans et faire revivre les souvenirs d’un authentique
habitant de ce quartier dont l’originalité restera dans l’histoire.
« Lous
graveichers »
Un de mes amis ponticauds m’expliquait, un tantinet nostalgique :
-
J’ai connu les derniers « dérateurs », c’est-à-dire
ceux qui avaient pour tâche de surveiller le flottage des bois dans la
Vienne. Ils suivaient dans leur course les rondins ou quartiers venant
de la région d’Eymoutiers et destinés au chauffage des fours de
porcelaine. Armés d’une perche, ils contrôlaient un parcours déterminé
et repoussaient vers le courant le bois qui s’accrochait aux rives.
Les
derniers survivants de cette profession avaient droit aux « canards ».
On appelait « canard » le bois qui coulait au fond de la
rivière. En plus de cette occupation peu rentable, ils se livraient à
la pêche. On les appelaient alors « Lous Graveïchers ».
Les
professions dominantes dans le quartier étaient « l’arrachage »
du sable et l’empilage du bois (ce dernier travail s’effectuait dans
les usines de porcelaine).
Le
chômage sévissait, et les nombreux porcelainiers du quartier devaient
revenir à leur Vienne pour vivre ou tout au moins les aider à vivre.
« La
Mentalité »
Vers le début du siècle, le Pont, le Naveix, le Masgoulet, une
partie du Sablard et le Clos Sainte-Marie étaient encore habités par
de vieilles familles ouvrières qui avaient entre elles des liens de
parenté de près ou de loin. A défaut de parenté, c’était la
familiarité et une mentalité toute particulière qui régissaient
leurs rapports.
S’il
fallait un exemple, il suffirait de rappeler qu’un enterrement
« du Pont » étaient reconnu
par tous les Limougeauds par le nombre d’amis et par la foule
imposante qui accompagnait les défunts jusqu’à Loyat.
Les
Ponticauds avaient tous des surnoms : c’étaient le grand Nini,
le vieux père Tonton, la Mimi, etc., etc…
Il
en reste encore quelques uns qui, continuant la bonne tradition, se réunissent
en des lieux bien à eux pour fêter les grands jours et, à l’instar
de leurs aînés, leur petite réunion familiale se prolonge tard dans
la nuit, accompagnée de vieilles chansons propres aux Ponticauds.
Il
faut aussi rappeler que le patois était le langage courant. On parlait
un patois spécial, agrémenté d’un accent particulier, et les
parents l’enseignaient aux enfants.
Ces
derniers fréquentaient les bords de l’eau autant que les bancs de
l’école, et les traditions des « ravageurs » ne
manquaient pas de se répercuter sur leurs divertissements buissonniers.
La glu, les pièges et les lignes voisinaient avec les livres et les
cahiers dans la carnassière. Il ne faut pas cacher non plus que les
mordus de la braconne emmenaient parfois les enfants afin de leur aider
à pousser le « comte » moyennant la promesse d’une petite
rétribution. Mais, comme me l’a dit mon ami, la promesse était
rarement tenue : elle était souvent remplacée par ces mots :
« Sauvo-té vité et ne dijo
ré, sans co io diraï à to maï ! »
Nous
ne pourrions passer sans parler des blanchisseuses. Leur réputation est
légendaire. Leur vaillance, leur ténacité au travail étaient
accompagnées d’une verve gouailleuse qui était connue de tous. Tous
ceux qui les ont approché reconnaissent aussi leur bon cœur et leur
esprit de solidarité.
La Flotte du
port du Naveix
La
pêche a toujours été la passion favorite des riverains, et les
Ponticauds s’y sont révélés des
maîtres.
Nous
parlerons des « battues » qui étaient préparées le jour
et qui se déroulaient la nuit, à la barbe des gardes et des
gendarmes.. Une dizaine de barques partaient en bataille dans le calme
d’une nuit tranquille. Quatre ou cinq bateaux tenaient le front
pendant que les autres faisaient un mouvement circulaire en partant des
rives et fermaient
la boucle dans laquelle le poisson ne pouvait échapper aux
fameux filets de nos hommes.
Et
la friture, cette fameuse friture qui a toujours été le meilleur des
cadeaux que puisse offrir un Ponticauds à ses amis, elle en coûtait
des peines et des déboires !
Il
faut dire aussi que la « battue » projetée n’était pas
toujours effectuée suivant le plan prévu. Non pas que les gendarmes
soient un sérieux obstacle, mais elle pouvait permettre l’excuse ou
l’alibi d’une petite bombance dans l’un des petits caboulots où
nos « ravageurs » se retrouvaient jusqu’à une heure avancée
de la nuit.
Les
femmes devaient écouter le matin l’explication de la « friture
manquée ». Elles écoutaient… et croyaient toujours… le motif
invoqué !
Cette
flottille de barques avait son port d’attache : Le Naveix. Elle
avait aussi son amiral : L’Amiral Coque-en-bois.
Une
chanson fort populaire avait mimé son autorité et son prestige.
André
Dexet (à suivre)

Une barque plate avec conte et épervier
carte postale, coll. J.-P. Della Giacomo
21
février 1951
Avec
les derniers « Ponticauds »
Si tu seï dau pount, passo !…
Et voici quelques anecdotes qui sont déjà
entrées dans la riche légende de nos Ponticauds :
Soir de Naufrage
Le
pré des Longes était un lieu agréable, offrant une verte pelouse dans
le cadre pittoresque et reposant des bords de l’eau.
Un
peu en amont du point Saint-Étienne, sur la rive gauche, ce coin
charmant était le lieu de rendez-vous des porcelainiers qui venaient y
passer le dimanche.
Ils
emmenaient la famille et emportaient le repas pour la journée. Le
matin, certains d’entre eux travaillaient aux jardins qu’ils
louaient dans les parages.
Un
certain soir d’été, deux de nos porcelainiers s’étaient attardés
plus que de coutume. Il faisait nuit noire et la lune avait commencé sa
ronde. Il faut dire que le retour en barque était assez bruyant, peut-être
un peu mouvementé par l’effet de quelques litres supplémentaires.
Nos deux hommes ramenaient un petit chargement de légumes.
La
barque chavira.
L’amiral
Coque-en-Bois était à son poste sur la barque de sauvetage, prêt à
parer toute éventualité. Il entendit des appels au secours et s’élança
afin de sauver nos deux porcelainiers en détresse.
Arrivant
sur les lieux du naufrage, il n’aperçut plus une seule trace ni de
nos hommes, ni de la barque. Seules, deux masses luisantes ayant un peu
la forme d’un crâne humain allaient à la dérive.
L’embarcation
de sauvetage eut vite fait de s’y diriger.
Le
moment était pathétique, tragique… Deux vies humaines étaient en péril !
Il
faut dire que, de la rive, un fort groupe de Ponticauds suivaient,
retenant leur haleine, les péripéties du drame.
L’amiral
eut un cri triomphant : «
Co l’y est, lous ténés. »
Il
aborda enfin et, au fond de la barque, on put voir deux superbes
« pommes » de choux !
Tant
qu’à nos « noyés », il y avait belle lurette qu’ils étaient
sortis de l’eau et commençaient à sécher leurs vêtements au
« bistrot » hospitalier.
L’amiral avait encore fait un coup d’éclat !
Les lavandières
Les
blanchisseuses de la rive droite avaient leur centre d’activité près
du Pont-Neuf. Il faut dire aussi que les pierres de nos lavandières
s’étalaient sur les deux rives sur une assez longue étendue. On ne
sait trop pourquoi on les avait surnommées les « tatas ».
Elles
avaient, nous l’avons dit, une réputation légendaire de travailleurs
irréprochables, mais avaient aussi la langue bien pendue.
Les
conversations bruyantes accompagnaient les bruits de battoirs. Les
discussions s’engageaient d’une rive à l’autre, et il fallait de
la voix pour converser. Elles ne mentaient jamais, mais, avouons-le,
elles déformaient un peu la vérité.
Un
jour, une brave vieille du Clos Sainte-Marie tomba malade. Les lavandières
demandaient de ses nouvelles et les commentaient. Elles apprirent un
matin que l’état de leur amie s’était aggravé. La nouvelle partit
du Pont-Neuf et remonta les deux rives.
Et
voici des bribes du dialogue :
Au
Pont-Neuf – Lo « Millou »
ne vai pas mie !
Entre
les deux ponts. – Lo « Millou » est chabado !
Au
pont Saint-Etienne. – L’oyo bé prou souffert !
Un
peu plus haut. – Lo ne s’interroro ma divendreï.
Et
enfin au bout de la lignée.
–
Né sabé pas s’à la onzé houras pourraï nâ à l’interramin !
La
brave vieille vécut encore deux ans.
**
Il
faut avouer que nos ponticauds avaient l’esprit empreint de moquerie.
Il était d’usage de jouer
les tours les plus fantaisistes à tous ceux qui voulaient bien s’y
laisser prendre.
On
raconte en effet qu’un de nos villageois d’Aixe-sur-Vienne en fit un
jour les frais.
Il
se promena d’une porte à l’autre, un dimanche matin, avec son
attelage, un tombereau de betteraves qui lui avait été commandé « per
lou lapins daus Pounticauds ».
Il repartit ainsi sans jamais avoir découvert le destinataire ou
l’entrepositaire de son lourd chargement.
**
Et
voici enfin celle qui arriva à « Marsau
dau Pount
» :
Marsau
avait une tante. Il allait souvent lui rendre visite, ne serait-ce que
pour rapporter de chez « lo
tota »
un précieux ravitaillement : œufs, volailles ou morceau de salé.
Il
pensa un jour qu’il vaudrait mieux emporter une poule de chez « lo
Tota », ce qui lui éviterait de revenir si souvent pour la
provision d’œufs frais. La tante accepta sous la promesse que sa
poule soit nourrie par Marsau à l’herbe fraîche, etc., etc…
Quelques
mois passèrent. Mais « Marsau » enviait un peu la belle
poule qui pouvait faire une bonne soupe. Il s’y décida et, las de la
nourrir, il en fit un bon pot-au-feu.
Quelque
temps après, il dut revenir chez la « Tota »
et fut obligé de réclamer une douzaine d’œufs.
Comme
la tante lui demandait des nouvelles de la bonne poule qu’il avait
promis de si bien nourrir, il lui déclara sans rire :
Chabo-té
i aï étâ obligea de lo tua, to charougno, lo né pougnio ma in yô
per jour !

Blanchisseuses en amont du pont
Saint-tienne, rive droite
coll. J.-P. Della Giacomo
« Si
tu sei dau pount »
Les Ponticauds ont toujours considéré le
pont et le quartier comme leur chose à eux seuls. Et s’ils recevaient
un ami, c’était en quelque sorte un privilège accordé !
Il
n’en repartait d’ailleurs qu’après avoir goûté aux meilleurs
choses offertes et en emportant le plus beau des cadeaux : la
friture.
La
vieille expression : « Si
tu seï dau pount, passo ! Si tu seï pas dau pount, à l’aïgo ! »,
trouve son origine dans cet amour jaloux pour leur quartier, avec ses
coutumes et toutes ses traditions.
Des
ministres, de hautes personnalités ont cru devoir venir à Limoges. Les
ponticauds les ont toujours bien accueillis, mais il faut noter une
dernière anecdote concernant la venue de Poincarré en notre ville.
Ils
firent éditer une carte postale indiquant en légende :
« Au
neï pas dau pount, ma laïsso lu passa per queta vê ; què cè
qui appelin nôtré presidint ! »
A.
D.
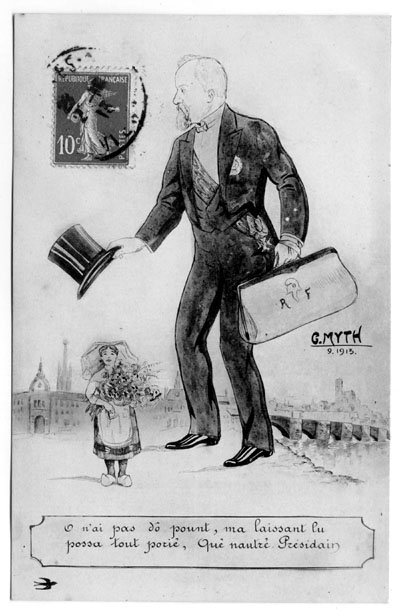
coll. J.-P. Della Giacomo
« Sauva te viste e ne’n dija ren, sens ‘quò io dirai a ta
mair » : « Sauve-toi vite et ne dis rien, sinon je
le dirai à ta mère ! »
« ‘Quò l’i es, los tene » : « ça y est, je les
tiens ».
« La Milon ne vai pas mielhs » : « La Millou
ne va pas mieux ».
« La Milon es chabada » : « La Millou est
perdue ».
« ‘L’aia ben pro sofert »
: « Elle a bien assez souffert ».
« ‘La ne s’interrarà mas
divendres » : « On l’enterrera seulement vendredi »
« Ne sabe pas s’a la onze oras porrai ’nar a l’enterrament » :
« Je sais pas si à onze heures je vais pouvoir aller à
l’enterrement ».
Per los lapins daus Ponticauds : « Pour les lapins des
Ponticauds »
Marsau dau Pont. Paru en occitan dans le Journal de
Panazô, n° 1, décembre 1957. Sur
ce site.
« ’Chaba te i ai
estat oblijat de la tuar, ta charonha, ‘la ne poniá mas un uòu
per jorn » : « Figure-toi que j’ai été obligé
de la tuer, ta charogne, elle ne pondait qu’un seul œuf par jour »
« Si tu ses daus ponts, passa,
si tu ses pas daus ponts, a l’aiga » : « Si tu es
des ponts, passe ! Si tu n’es pas des ponts, à l’eau ! »
« Eu n’es pas daus ponts, mas laissa lo passar per questa
vetz ; qu’es se qu’ilhs appelen nòstre president » :
« Il n’est pas des ponts, mais laisse-le passer pour cette
fois ; c’est lui qu’ils appellent notre président ».
En fait, on trouve écrit sous cette carte, une inscription plus
claire : « O n’ai pas dò pount, ma laissant lu possa
tout parié, qué nautré Présidain », c’est-à-dire en
graphie normalisée : « Eu n’es pas daus ponts, mas
laissam lo passar tot parièr, qu’es nòstre president »
(voir image jointe).
|